Dans son ouvrage Cancer et parcours de soins, l’odyssée du malade*, Michel Bolla, professeur émérite de cancérologie et radiothérapie à l’université Grenoble Alpes, explore en détail le parcours des patients atteints du cancer : annonce, traitements, surveillance jusqu’à l’horizon de la guérison, en passant aussi par la recherche clinique et la prévention, offrant ainsi une vision complète du paysage oncologique.
Votre ouvrage débute avant même le diagnostic de la maladie. Pourquoi ?
Michel Bolla. Habituellement, face à la persistance ou l’aggravation de symptômes inhabituels, la personne consulte son généraliste. Selon l’hypothèse diagnostique, il peut demander un bilan biologique et/ou radiologique, puis orienter le patient vers le spécialiste d’organe qui réalisera un prélèvement tumoral pour affirmer le diagnostic. C’est un parcours long, au cours duquel l’hypothèse de cancer passe de la probabilité à la certitude.
Comment se déroule l’annonce ?
M. B. L’annonce du diagnostic de cancer est un mélange de vérité et d’humanité qui requiert de la part du médecin expertise clinique et empathie. C’est un coup de tonnerre existentiel pour le patient qui pourra bénéficier ensuite d’un entretien auprès d’une infirmière d’annonce qui reformulera les propos du médecin. Le patient doit comprendre sa maladie et les objectifs du traitement pour mieux la combattre, d’où l’importance de la relation médecin-malade pour établir un climat de confiance.
Quelles sont les étapes suivantes ?
M. B. Après le diagnostic, le bilan d’extension (endoscopie, scanner, IRM, scintigraphie…) va définir le stade du cancer. Puis le dossier du patient est présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), en présence du médecin responsable, du spécialiste d’organe, du chirurgien, du radiothérapeute et de l’oncologue médical. La RCP est fondamentale pour définir le choix du traitement, modulé par l’âge et l’état général. Une fois le traitement terminé et évalué, une surveillance pluridisciplinaire de 5 ans minimum est alors proposée, grevée parfois d’une rechute qu’il faudra prendre en charge.
Quels sont les différents traitements possibles ?
M. B. Il n’y a pas un, mais une mosaïque de cancers. Les plus fréquents sont les tumeurs solides (sein, prostate, colon, rectum, tête et cou…). Lorsqu’ils sont localisés, ils requièrent un traitement locorégional – chirurgie, radiothérapie ou leur association – avec un traitement médical systémique selon le stade et la présence de facteurs de pronostic péjoratif : chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie. Les cancers du sang (leucémies aiguës ou chroniques) et ceux des ganglions lymphatiques (lymphomes), beaucoup moins fréquents, sont soumis à la chimiothérapie et l’immunothérapie.
Quelles sont actuellement les pistes porteuses d’espoir dans le traitement des cancers ?
M. B. La chirurgie robotisée et la radiothérapie guidée par l’image avec modulation d’intensité sont de plus en plus efficaces. La chimiothérapie privilégie des médicaments respectant mieux les cellules saines. Les thérapies ciblées (qui s’attaquent aux anomalies moléculaires épargnant les cellules saines) et l’immunothérapie (qui utilise les éléments du système immunitaire pour le renforcer) ont révolutionné le traitement du cancer en phase métastatique. La survie nette à 5 ans des cancers ne cesse de s’améliorer : 93 % pour le cancer de la prostate contre 72 % en 1993, 88 % pour le cancer du sein contre 79 %, 63 % pour le cancer du côlon-rectum contre 51 %.
Comment le patient est-il accompagné pour surmonter les événements indésirables liés aux traitements ?
M. B. Ces événements sont enregistrés selon leur grade de gravité. Des recommandations sont proposées pour les prévenir ou les atténuer. Par exemple, avant chaque cure de chimiothérapie, un examen clinique et un bilan biologique sont réalisés pour évaluer la tolérance clinique et biologique du patient, et selon, modifier la dose du médicament ou retarder la cure, en recourant si besoin à des facteurs de croissance pour corriger une baisse des globules rouges ou des globules blancs. Le risque de perte de cheveux est réduit par le port d’un casque réfrigérant pendant la perfusion et le port d’une perruque, prise en charge par la mutuelle, est prescrit si nécessaire.
Comment favoriser la qualité de vie du patient ?
M. B. En prêtant attention à sa douleur, à l’altération de son état nutritionnel, à sa souffrance psychologique, et à toute difficulté administrative, juridique ou sociale. Selon le besoin, une consultation de la douleur, un accompagnement psychologique ou le recours à une assistante sociale lui sont proposés. Les espaces de rencontre et d’information (ERI), lieux d’écoute et d’échanges des établissements de soins, lui apportent aussi un soutien pour métaboliser son angoisse et lui redonner confiance.
Quelle place l’intelligence artificielle (IA) et la télémédecine occupent-elles ?
M. B. L’IA investit progressivement la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et la recherche de médicaments innovants. À domicile, une plateforme disposant d’un questionnaire adéquat peut permettre aux patients de communiquer leurs événements indésirables et leurs résultats biologiques aux centres de soins pour améliorer la tolérance et procéder, le cas échéant, à une adaptation de la posologie du médicament incriminé. Dans certains cas, la télésurveillance peut faciliter le suivi à distance du patient.
Quels critères permettent d’attester une rémission ?
M. B. L’évaluation du traitement a lieu habituellement 6 semaines à trois mois après son terme. Elle prend en compte les données de l’examen clinique, du bilan biologique et de l’imagerie réalisée à distance du traitement. La rémission complète, définie par la disparition des signes cliniques, radiologiques et biologiques du cancer, est fréquemment observée dans le cadre de cancers localisés.
L’accompagnement en soins palliatifs peut malheureusement aussi faire partie du parcours.
M. B. Quand le cancer évolue en dépit des traitements, les soins palliatifs prennent le relais pour accompagner le patient, préserver sa dignité et sa qualité de vie jusqu’à la fin. L’équipe, composée de médecins, psychologues, soignants, aides-soignants, kinésithérapeutes, assistants sociaux, bénévoles, etc., prend en compte la personne dans sa globalité. Notons toutefois que 21 départements en métropole sont actuellement dépourvus de structures de soins palliatifs.
Quelles recommandations sont proposées pour prévenir les risques de cancers ?
M. B. On estime que 40 % des cancers relèvent de l’exposition à des facteurs de risque évitables liés aux modes de vie et aux comportements, voire à des facteurs environnementaux ; d’où l’observance de recommandations censées sensibiliser et responsabiliser, sans culpabiliser, en adoptant une bonne hygiène de vie. Quelques exemples : pratiquer une activité physique régulière, observer une alimentation saine, ne pas fumer et ne pas dépasser 10 verres d’alcool par semaine, éviter de s’exposer au soleil au milieu de la journée et utiliser une crème solaire adaptée, lutter contre l’obésité qui prédispose au cancer. La vaccination contre l’hépatite B, et contre les papillomavirus humains (HPV) responsables du cancer du col de l’utérus (pour les filles et garçons de 11 à 14 ans avec rattrapage de 15 à 19 ans) est recommandée. Il convient aussi de s’en remettre à une décision partagée avec le médecin à l’égard du traitement hormonal substitutif de la ménopause avant 60 ans pour une durée maximum de 5 ans. Enfin, l’exposition aux cancérogènes avérés – amiante, arsenic, benzène, poussières de bois, radiations ionisantes – est étroitement surveillée dans le cadre de la médecine du travail.
Vous rappelez enfin l’importance d’un diagnostic précoce.
M. B. Le dépistage organisé de 50 à 74 ans du cancer du sein, du côlon-rectum dans les deux sexes, et du col de l’utérus (de 25 à 65 ans) est pris en charge totalement. Il permet un diagnostic précoce garant d’un taux de guérison accru, d’un traitement conservateur (cancer du sein notamment) et d’une meilleure qualité de vie.
* Cancer et parcours de soins, l’odyssée du malade, Michel Bolla, L’Harmattan, 168 pages, 19 euros.
Post Facebook :
Dans son livre Cancer et parcours de soins, l'odyssée du malade (#éditionslharmattan), Michel Bolla professeur émérite de cancérologie et radiothérapie #UniversitéGrenobleAlpes, explore le parcours complexe des patients, depuis l’annonce du diagnostic jusqu’à la guérison. Des traitements innovants comme la chirurgie robotisée et l’immunothérapie ouvrent de nouvelles perspectives. Mais le soutien psychologique, l’accompagnement personnalisé et la prévention restent les clés d’un parcours réussi.
#cancer #santé #patient #malade #prevention

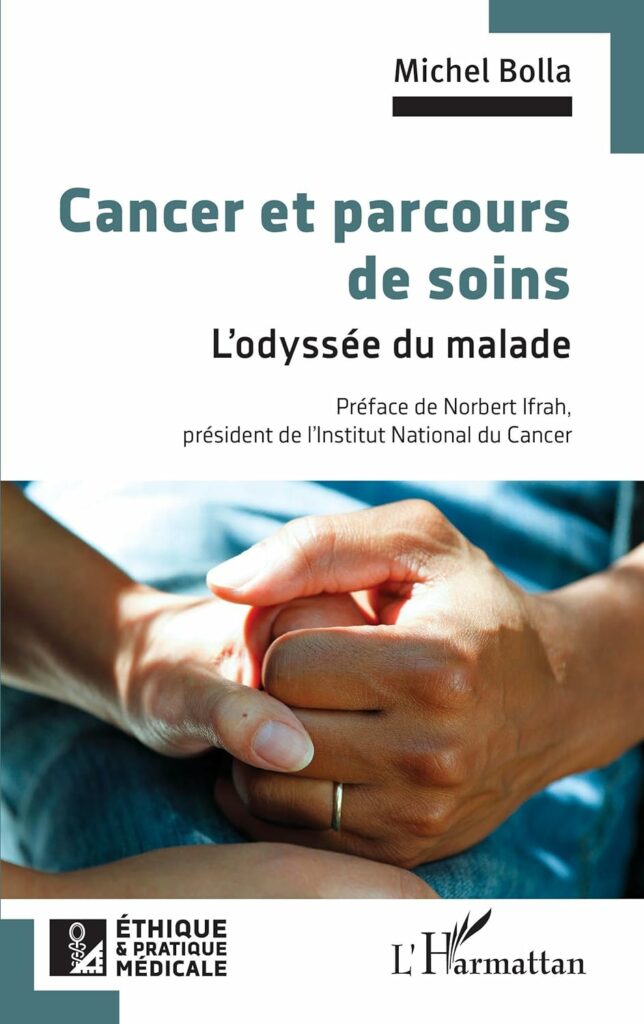
Astuce
Un évènement, un produit, une offre… pensez à compléter les articles avec des actualités de votre mutuelle.
